Matière hebdomadaire – Résumé des textes – Recherche
Peau rouge, masques blancs
Par Glen Sean Coulthard
- Réclamation de l’autodétermination des peuples autochtones canadiens par le biais de la reconnaissance
Déclaration formelle (1975)
- Reconnaissance : Être considérée comme une nation par tout le monde (individus et gouvernements à l’échelle internationale)
[Nation dénée : Organisation politique créée en 1969, alors nommée Fraternité des Indiens des Territoires du Nord-Ouest, qui milite pour les droits et les intérêts du peuple dené]
- Autodétermination : Détermination du statut politique d’un pays par ses habitants (indépendant du reste du Canada)
Reconnaissance affirmative ou accommodation institutionnelle des différences culturelles/liberté et autonomie des individus et des groupes marginalisés sur le plan ethnique
Avant 1969, les politiques canadiennes prônaient l’assimilation ouvertement
« L’on devient un sujet individuel seulement lorsque l’on reconnaît un autre sujet et que cet autre sujet nous reconnaît. » Hegel
Reconnaissance mutuelle : Notre identité dépend des rapports interpersonnels, elle est subjective.
L’identité est façonnée autant par la reconnaissance que par la non-reconnaissance/reconnaissance erronée des autres…
Dénaturation et dommages liés à cette image réductrice, péjorative et méprisante (oppression)
Selon Charles Taylor
Au Canada, le peuple québécois et les peuples autochtones sont des minorités menacées qui devraient recevoir une reconnaissance visant à accommoder leur singularité culturelle
Comment?
Chez les peuples autochtones… Obtention d’une autonomie culturelle et politique (autogouvernement) pour préserver leur intégrité culturelle et leur liberté
Institutionnalisation d’un régime libéral de reconnaissance réciproque = Statut d’agents distincts et autodéterminés
- La reconnaissance est accordée par le groupe dominant (avantage, position de force)
- Les relations coloniales ne pourront jamais faire fi de leur passé (abus de pouvoir, dominant-dominé)
L’État a considéré certaines revendications territoriales pour calmer les revendications de propriétés et de droits globales des Premières Nations en leur accordant un éventail limité de droits et d’avantages…
La souveraineté de l’État colonial et le capitalisme demeurent malgré tout…
Uapaki (Pour demain)
Par Joséphine Bacon
Texte issu d’une conversation avec Laure Morali
« Nous perdons de vue les choses qui nous unissent intimement à la terre. » N. Scott Momaday
[La culture autochtone en fait partie]
« Quand on vit dans une culture dominante, c’est le contenu de l’œuvre qui cherche ou ne cherche pas à être engagé, qui se veut ou non politique. Mais lorsque, comme moi, on appartient à un peuple minoritaire dont la langue et la culture, menacée d’extinction, ont été la cible d’une politique d’éradication, faire acte de présence est déjà un geste de désordre politique. »
Pourtant, les Innus ne pouvaient pas se permettre le désordre en tant que nomades
- Leurs déplacements, leurs gestes, la gestion de la nourriture suivaient les saisons et le cycle de vie des animaux en valorisant le partage et la solidarité
[Les colonisateurs ont amené le désordre dans cet équilibre]
« Tout Innu sait que venir troubler l’ordre naturel aura des conséquences. »
Le désordre est apparu avec la sédentarisation forcée
- Séparation des enfants et de leur famille, création de réserves et de pensionnats indiens (« tuer l’Indien dans l’enfant »), séparation des hommes qui partaient chasser et des femmes qui restaient pour attendre le retour des enfants
La séparation des familles favorisait la prise de possession des terres et leur exploitation
« Ils ont tué le nomadisme, ce qui en retour a tué le territoire, parce que la région a vu venir des gens qui cherchaient des limites. » [L’équilibre n’y était plus]
Les pensionnats indiens ont brimé les peuples de leur langue et de leur culture (légendes, traditions, habits)
Le but était l’acculturation, mais ils ont donné aux jeunes les outils pour défendre leur culture, parler en leur nom et se faire comprendre aujourd’hui
… Ils n’ont jamais été aussi présents qu’aujourd’hui dans les sphères culturelle, sociale et politique !
Écrire dans sa langue est une action militante perçu comme un désordre alors qu’il s’agit de ramener l’ordre ancestral dans les communautés et les relations avec les allochtones.
« Le fait de pouvoir publier des œuvres en notre nom est un renversement de l’ordre établi depuis des générations. »
Les anthropologues et les linguistes allochtones ont joué un rôle dans la réappropriation culturelle en traduisant et en publiant les mythes fondateurs pour exposer au grand jour leur réalité, non pas celle racontée par d’autres.
Le mode de vie sédentaire a fait disparaître les mots liés au nomadisme :
« Nutshimit-aimun, la langue de l’intérieur des terres, est une langue née de la terre. Elle est différente de celle qu’on utilise dans les villages ou les villes de la côte. »
La langue des anciens assure la survivance, la transmission de la culture aux générations futures
[Les écrivains autochtones se la réapproprient, ils ne l’empruntent pas.]
La littérature rassemble (tradition), renforce les liens, donne de l’espoir
« Tandis que l’on parle beaucoup d’appropriation culturelle, je suis plutôt quelqu’un qui crée des complicités culturelles. Il est impossible de vivre chacun de son côté aujourd’hui. Il ne faut pas non plus aller dans le sens du ghetto dans lequel on a voulu nous enfermer. Si la relation est basée sur l’égalité, l’échange, la curiosité et le respect de l’autre, l’harmonie apparait. Je crois au pouvoir du dialogue et de la co-naissance. Il nous faut créer un nouvel ordre porté par des créations communes. »
« L’important, pour moi, au-delà de faire connaitre ma culture et ma langue, est d’être considérée comme poète, tout simplement. » «Innu» signifie «être humain»
L’institution est-elle prête à lire un auteur sans considérer ses origines?
L’écrivain exotique est vendeur – phénomène culturel de goût pour le passé/l’étranger
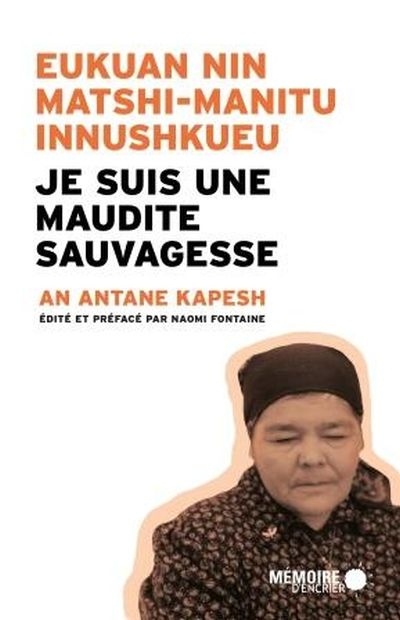
Les Indiens n’ont jamais consenti à ce qui leur est arrivé parce qu’ils n’en savaient rien; Les colonisateurs se sont imposés en profitant de leur innocence et de leur bonté pour s’approprier leurs terres et assimiler la population.
[Ils ne leur ont jamais rien demandé, alors qu’aujourd’hui, eux doivent signer des attentes pour pouvoir reprendre un peu de ce qui leur appartient]
Les Blancs donnaient l’impression d’être généreux (maigre allocation, réserves, éducation) – Tout ça pour faire diversion alors qu’ils voulaient les sédentariser, exploiter leur territoire et les acculturer
Absurdité, mensonge et manipulation – Blâme sur les Indiens qui étaient ignorants
Sans autorisation, sans avertissement :
- Pollution des eaux
- Construction de barrages, de mines : exploitation des terres jusqu’à épuisement sans leur en faire profiter ($)
« Et vous, les Indiens, vous fonctionnerez comme fonctionnent les Blancs; que vous en soyez capables ou non, vous aussi, c’est comme cela que vous devrez fonctionner. »
Acculturation et perte de repères :
- Noms de famille et langue du colonisateur
- Lois et règlements des Blancs (aucune utilité pour les Indiens et que se gouvernaient et se suffisaient eux-mêmes)
Le Blanc cherchait un gagne-pain, mais pourquoi il n’a pas gardé sa culture pour lui…
Dans la culture blanche, la scolarité démontre l’intelligence…
Ça ne veut pas dire que les Indiens n’étaient pas intelligents, survivre leur demandait de l’intelligence (survie en nature, connaissance du territoire, besoins de base, etc.)
L’écrit ne faisait pas partie de la culture indienne, c’était plutôt la transmission orale qui faisait récit de l’histoire
[La vraie histoire s’est donc perdue dans les livres écrits par d’autres]
« Et je pense que, maintenant que nous commençons à écrire, c’est nous qui avons le plus de choses à raconter puisque nous, nous sommes aujourd’hui témoins des deux cultures »
Exotisme et déformation de la vie d’autrefois (la fête du minerai)
Le Père Babel s’est fait donner le mérite alors que c’est un Indien qui avait confiance en lui qui le lui a montré…
Les colonisateurs ont pris avantage des peuples autochtones, ils n’ont pas respecté les traités signés et se sont déresponsabiliser de ce génocide en s’appuyant sur les retombées économiques
Autres thèmes abordés dans le livre…
Explication du titre :
Ils ont été forcés de croire qu’il s’agissait de leur nature à force d’être traités comme un peuple inférieur, ils ont fini par y croire. Vivre à l’état sauvage, c’est vivre en liberté, dans la nature. C’est en quelque sorte ce qui les représente, eux qui vivaient dans le bois et qui étaient en relation avec la nature. Ils étaient libres avant l’arrivée des Blancs, avant d’être assimilés. Elle préfère donc être une sauvagesse, une vraie indienne, qu’être considérée comme quelqu’un qu’elle n’est pas. Elle préfère se l’approprier que de le prendre comme une insulte.
Problématique de la couverture médiatique :
Ils montrent une fausse réalité : ce n’est pas eux qui sont représentés, c’est une population à qui on a enlevé une culture et une histoire. Ils ne peuvent pas connaître la réalité de ce peuple, car leur vie est maintenant très différente d’autrefois. Ils vivent comme on leur a appris à vivre dans un système qui ne leur convient pas, qui ne convient pas à leur culture.
La civilisation chez les Blancs vs chez les Indiens :
La civilisation pour les Blancs c’est l’état de développement économique social, politique et culturel auquel une société parvient et qui est considéré comme un idéal à atteindre. À leur arrivée, la société indienne n’était pas structurée et organisée comme les sociétés que l’on connait aujourd’hui (école, justice, religion). Alors que pour les Innus, être civilisé c’est d’abord faire preuve de bonnes manières, adopter un savoir-vivre. Les Innus ont toujours été très accueillants avec les étrangers, ils en ont pris soin contrairement aux Blancs qui se sont imposés et qui ont maltraité une population sur leur propre territoire.
Rapport final CERP
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics : écoute, réconciliation et progrès
Motivations :
Les Canadiens-Français de la province de Québec sont minoritaires (langue, religion, valeurs) et décident d’occuper un plus grand territoire pour gagner du pouvoir
- Marginalisation économique, manque de terres et de débouchés économiques
- Exode urbain (États-Unis)
Objectif : Arrêter l’émigration et assurer la survie de la culture française et catholique
Comment? La colonisation (supportée par le gouvernement)
Les historiens tendent à évacuer les Premiers Peuples de l’histoire nationale alors qu’on parle de leur territoire comme étant quasi désert à l’arrivée des Européens. Ils étaient présents, mais leur mode de vie ne faisait pas d’eux un peuple civilisé. C’est donc ce que croit le Québec au moment où il songe à occuper, développer et agrandir son territoire…
- Autochtones sont infantilisés et considérés non-civilisés, contre le progrès
[Excuse]
Paradoxalement, les peuples autochtone se détériorent (culture et territoires)
- Diminution de la superficie de leur territoire
- Exploitation de leurs ressources
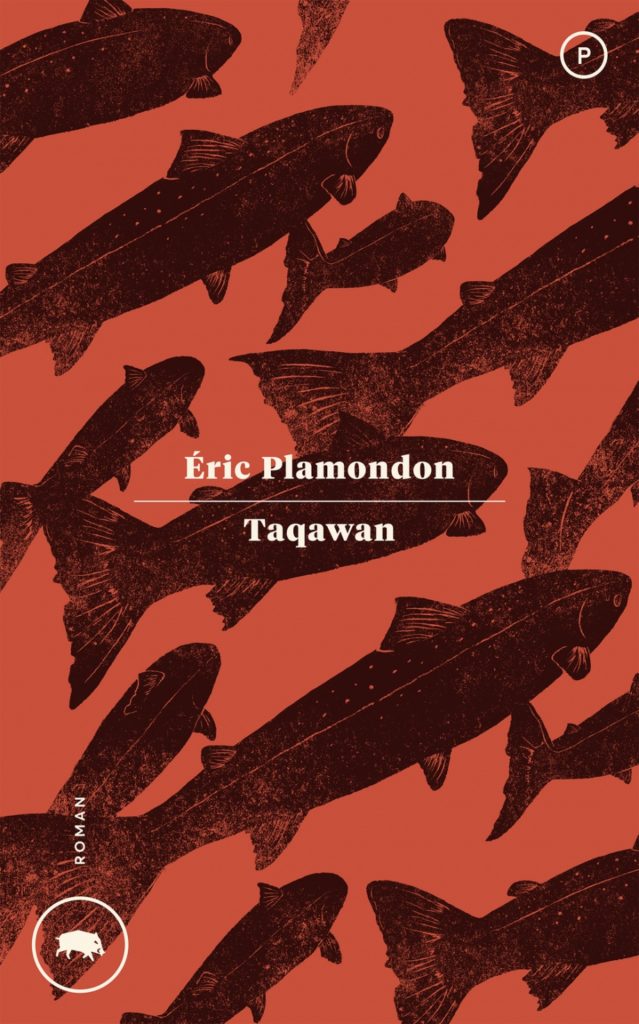
Extrait :
« Pourquoi le gouvernement québécois ne veut pas donner aux Indiens ce qu’ils demandent lui-même au gouvernement canadien? Pourquoi faut-il un droit à la culture et à la langue française à l’intérieure du Canada, mais pas de droit à la culture et à la langue Mi’gmaq à l’intérieur du Québec? »
Les religieux sont les principaux responsables du développement des « nouvelles » régions à partir de 1840 :
- Séjour de prêtres en territoire autochtone
- Remplacement des pratiques et des croyances ancestrales (diaboliques aux yeux du christianisme)
- Soutien matériel et soins médicaux
Plus tard, création de réserves et de pensionnats indiens
Le gouvernement accorde des droits d’exploitation des ressources (forestières, animales) aux entreprises privées = débordement de l’exploitation jusque dans les réserves
[Aucun respect contre un peuple sans défense]
Les colons ne faisaient pas attention à la nature, à leur environnement (feux, surexploitation) [Individualisme marqué : aucune conscience de l’empreinte qu’ils laissent et des conséquences que ça aura]
Changements avec l’arrivée de colons
(Le mode de vie semi-nomade des Autochtones est chamboulé)
- L’industrie forestière
- La construction d’infrastructures (chemin de fer)
- Le braconnage
- L’exploitation des mines
- L’usine de pâtes et papiers : coupes forestières importantes, encombrement des rivières (difficile de se déplacer sur l’eau)
- Barrages et réservoirs qui inondent les terres jusqu’à la perte
Lois et règlements qui briment la liberté des Autochtones :
- Encadrement législatif des activités traditionnelles (quotas de pêche et de chasse par saison, dans des lieux déterminés)
- Interdiction de pratiquer certaines méthodes de chasse traditionnelles
On leur reprend la nourriture qui a été chassée hors-saison et on les emprisonne pour avoir fait du troc avec la viande… [C’est ainsi qu’ils vivaient! Rien pour mal faire. Ils n’avaient pas besoin de cet encadrement pour fonctionner. Ils avaient conscience des limites de leur environnement. Ils ne les connaissent pas et ne cherchent pas à les connaître.]
L’Acte des pêcheries permet au gouvernement de céder les droits de pêche sur les rivières à saumon à des intérêts privés… Les droits des Autochtones n’avaient pourtant jamais été cédés. [Ils ne font pas partie de l’équation, ils sont complètement ignorés]
Étrangers chez eux : Ils étaient dans le chemin de tout le monde, de toutes les compagnies
« Et puis d’occuper le territoire, t’sais, parce que là, on occupait le territoire, mais on était à… sur le chemin compagnies forestières, sur le chemin de l’Hydro-Québec, sur le chemin des compagnies minières. Il fallait nous… nous tasser. Il fallait nous exclure. » Richard Kistabish
Bonne relation avec les Autochtones [seulement] lorsqu’ils apportent à l’économie par leurs connaissances et leur aide (traite des fourrures)
Les Autochtone sont obligés de s’adapter à leur nouvel environnement :
- Nouveaux emplois dans l’exploitation des ressources, la construction d’infrastructures ou comme guide pour les nouveaux occupants)
- Ils devaient trouver une source de revenu maintenant que tout était payant
Les Autochtones ont permis le développement et l’exploitation de leur territoire grâce à leurs connaissances et leur sensibilité à leur environnement
Seule la terre est éternelle
Par Jim Harrison
« L’enfant est le père de l’homme » à notre insu
On devient parfois ce qui n’était pas encouragé plus jeune, nos traumatismes nous forgent
La religion justifie ce que nous avons fait de la terre plutôt que de nous enseigner à prendre soin de la vie qu’elle nous donne…
L’humain à tendance à refuser de voir l’entière vérité :
Nous cherchons à connaître ce qui nous convient, en laissant de côté le plus laid (nos torts) pour ne pas se sentir coupable ou se sentir obligés de faire quelque chose
[Peu d’empathie]
Pour que les problèmes soient vrais et valides, ils doivent être considérés en justice, autrement il n’y a pas de changement social.
« C’est Bertolt Brecht qui a dit que ceux que nous voulons détruire, nous les appelons d’abord sauvages. » [Pour se déculpabiliser, se justifier]
Les médias sont responsables de perpétuer des préjugés à leur égard en contrôlant ce qui est dit ou non. L’école est responsable de ne pas nous enseigner à vivre en relation avec la nature. Le cinéma est responsable de transformer l’histoire en un film dépourvu d’humanité et d’un lourd passé.
- Ce qu’on s’efforce de cacher vire inévitablement mal
Xénophobie : Hostilité de principe envers les étrangers, ce qui vient de l’étranger.
[Pourquoi vouloir la parité?]
Les communautés noires et les Premières Nations sont opprimées alors qu’ils sont les premiers peuples. Pourquoi vouloir renier l’histoire et les considérer non-civilisés alors qu’ils sont au fondement des sociétés d’aujourd’hui…
Culture différente : en harmonie avec la nature, importance accordée à la spiritualité, respect des ancêtres
« Plus de cinq cents tribus ont été réduites à un seul nom, les Sauvages, les Indiens, les Peaux-rouges… » Régions différentes, peuples différents, culture différentes
L’histoire des peuples indiens est racontée comme quelque chose du passé, des peuples morts.
« À aucun moment de notre histoire, le fossé entre la perception du public et la réalité n’a été aussi grand. »
« J’ai appris qu’on ne peut pas comprendre une autre culture tant qu’on tient à défendre la sienne coûte que coûte. »
Théorie de la justice
Par John Rawls
Justice comme équité (établie dans un accord équitable, mais deux valeurs différentes)
- Chaque personne d’une société établit son bien et toutes décident ensemble de ce qui est juste et injuste
- Définir les principes généraux de justice pour organiser la société (lois)
Pas de système de coopération dans lequel les hommes s’engagent volontairement si on se trouve déjà dans une position et une société particulières qui influencent le cours de notre vie et nos perspectives d’avenir.
Contrat (justice) : Nature publique des principes politiques
La théorie aborde les relations que nous avons avec autrui, mais ne tient pas compte de notre apport à notre environnement
« Et je pense que, maintenant que nous commençons à écrire, c’est nous qui avons le plus de choses à raconter puisque nous, nous sommes aujourd’hui témoins des deux cultures » An Antane Kapesh
Tout comme la communauté noire, la communauté autochtone fait partie des premiers peuples du monde et pourtant, rien n’a empêché les colonisateurs blancs de voler son territoire, de l’humilier et de lui enlever sa culture. En voulant défendre sa nation, le peuple canadien-français a provoqué la détérioration des peuples autochtones. Après avoir déshumaniser la population et exploiter les ressources du territoire jusqu’à épuisement, il semble encore difficile d’admettre complètement les torts causés à ses nations qui cherchent à être pleinement reconnues comme groupes et comme individus à part entière. Comment sommes-nous arrivés à convaincre un peuple qu’il n’était moins que rien après tout ce qu’il a fait pour la nature et les colonisateurs?
Au 19e siècle, les Canadiens-Français de la province de Québec sont minoritaires. Leur langue, leur religion et leurs valeurs se distinguent du reste du Canada. La marginalisation, le manque de terres et de débouchés économiques mènent à un exode urbain dans les grandes villes ainsi qu’aux États-Unis. Pour contrer l’émigration et assurer la survie de la culture française et catholique, ils décident d’occuper un plus grand territoire pour gagner du pouvoir. Le gouvernement supporte l’idée de se réapproprier des terres qui drôlement ne leur ont jamais appartenu. À cette époque, le territoire habité par les Premières Nations est décrit comme étant presque désert. Pourtant, les peuples autochtones étaient présents, mais leur mode de vie ne faisait pas d’eux un peuple civilisé.
La civilisation pour les Blancs c’est l’état de développement économique, social, politique et culturel auquel une société parvient et qui est considéré comme un idéal à atteindre. À leur arrivée, la société indienne n’était pas structurée et organisée comme les sociétés que l’on connait aujourd’hui : l’école, la justice et la religion n’étaient pas institutionnalisées. Toutefois, pour les Innus, être civilisé c’est d’abord faire preuve de bonnes manières et adopter un savoir-vivre. Ils ont toujours été très accueillants avec les étrangers et ils en ont pris soin contrairement aux Blancs qui se sont imposés et qui ont osé maltraiter un peuple sur son propre territoire. Malgré qu’ils étaient de bons guides experts de leur environnement et une main d’œuvre profitable, la xénophobie régnait.
Dire des peuples autochtones qu’ils sont désorientés ou désordonnés, c’est seulement vrai depuis que les colonisateurs sont arrivés. « Et vous, les Indiens, vous fonctionnerez comme fonctionnent les Blancs; que vous en soyez capables ou non, vous aussi, c’est comme cela que vous devrez fonctionner. »[1] Imaginez être retiré de sa famille, apprendre dans une langue qu’on ne connaît pas, prier pour un dieu qui n’est pas le nôtre, être régit par des lois qui n’ont jamais été nécessaires, être punit pour vivre comme on le faisait, en plus d’être forcé d’habiter à un endroit délimité alors qu’on était nomade. C’est tout à fait normal d’être déstabilisé devant la perte de nos repères.
Il est difficilement envisageable d’espérer une réconciliation sincère entre les peuples autochtones et les Blancs. Une relation coloniale est basée sur l’abus de pouvoir du groupe dominant sur le groupe dominé et il est évident que leur perception quant à l’autre est changée à jamais. Non seulement la population a été manipulée, trompée, mais on a profité de son innocence en se faisant passer pour des sauveurs à coup de maigres allocations, de maisons et d’écoles, et ce pour faire diversion et les amadouer pour qu’ils coopèrent.
La reconnaissance de cette nation dépendra toujours du groupe dominant et celui-ci ne l’a jamais considérée avant qu’on lui réclame. Cette non-reconnaissance comporte son lot de conséquences; à force de les mépriser et de les dénigrer, l’estime du peuple et de sa culture est heurtée. Il est possible que les Autochtones aient pensé un moment que les Blancs avaient raison, qu’ils étaient plus intelligents. Ils ont été forcés de croire qu’il s’agissait de leur nature à force d’être traités comme un peuple inférieur.
Il est curieux d’avoir une image péjorative du mot « sauvage » alors qu’en fait ça représente en quelque sorte ceux qui vivaient dans le bois et qui étaient en relation avec la nature. C’est peut-être ce qu’An Antane Kapesh essaie de nous dire avec le titre de son roman Je suis une maudite sauvagesse. Elle préfère être une sauvagesse, une vraie indienne, qu’être considérée comme quelqu’un qu’elle n’est pas. Il vaut mieux se l’approprier que de le prendre comme une insulte. « C’est Bertolt Brecht qui a dit que ceux que nous voulons détruire, nous les appelons d’abord sauvages. » Les colonisateurs ont choisi de les infantiliser et de les voir comme une menace au progrès. Encore une fois, pour se déculpabiliser et se justifier d’avoir trahi un peuple de la sorte.
La réappropriation culturelle chez les communautés autochtones se fait de plusieurs façons, mais l’écriture demeure un moyen très efficace bien que ça n’appartienne pas à leurs traditions. Enfin, on peut connaître leur version des faits, la bonne si je ne m’abuse. La littérature rassemble, elle permet de reprendre contact avec la langue des anciens non pas en l’empruntant, mais en se la réappropriant pour pouvoir la léguer à leur tour et dépeindre un portrait réaliste de leur culture. C’est bien le seul avantage que l’école francophone aura permis à certains : former des jeunes qui peuvent parler en leur nom, au nom de toute la nation pour défendre ses droits et ses intérêts et se faire comprendre des autres. Il est désolant qu’on soit plus à l’écoute maintenant que les peuples autochtones sont empreints de notre culture et qu’il est manifestement trop tard pour revenir en arrière.
Il est évident que nos institutions n’ont pas toujours été bien intentionnées, surtout quand il est question d’argent. Non seulement le récit est passé sous silence durant de nombreuses années, mais il a été déformé et biaisé par les médias. Ils sont responsables d’avoir perpétuer des préjugés sans établir le contexte et les faits. Le gouvernement aussi est à blâmer pour son ignorance volontaire des crimes commis et le manque de soutien et de reconnaissance envers ses nations opprimées détruites légalement. L’Église, elle, est responsable de l’assimilation des populations et de certains traumatismes irréparables. Et cette culture du divertissement qui tend à avoir recours au passé pour son exotisme plutôt que pour sa valeur intrinsèque, elle aussi ridiculise la situation en nous montrant seulement ce qui nous convient pour éviter de se sentir coupables et de devoir faire face au changement.
Médiagraphie
Asch, Michael I. « Nation dénée (organisation) | l’Encyclopédie Canadienne
L’encyclopédie canadienne, www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nation-denee.
Consulté le 10 mai 2022.
PLAMONDON, Éric. Taqawan, Montréal : Le Quartanier, 2018, 214 p. (Coll. « Écho »).
Kapesh, An Antane et al. Je suis une maudite Sauvagesse Eukuan nin matshi-manitu innushkueu. Mémoire d’encrier, 2019.
Tous les textes trouvés sur : http://www.philo-cvm.ca/?p=14450
[1] Kapesh, An Antane et al. Je suis une maudite Sauvagesse Eukuan nin matshi-manitu innushkueu. Mémoire d’encrier, 2019.
