
Ces questionnements sont peut-être banals, mais vont selon moi, à la source du problème. Selon moi, le problème commence d’abord et avant tout, dans l’appellation. Nous (les humains) faisons tous partis de la race humaine. Pourtant, à travers les siècles, nous nous sommes, nous-même, divisé, en plusieurs soi-disant, races (Blanc, Noir, Autochtone et autres). Nous avons décidé de se distinguer avec des noms, de simples mots, mais qui veulent dire beaucoup. La puissance de ces mots me fascine… Par exemple, être Noir… Être Noir veut dire beaucoup. Cela me fait penser à ma tante. Lors d’un souper de famille, elle s’est confessé à ma mère; elle lui a confié qu’elle a décidé d’avoir des enfants (mes cousins) avec un Blanc, car elle ne voulait pas que ces enfants vivent la vie d’être Noir. Confession assez choquante pour ma part. Bref, je ne veux pas trop m’éloigner du sujet alors revenons sur l’appellation.
Je m’explique: à travers l’appellation, il est facile de discriminer un groupe, ou encore, de discerner du racisme. Par exemple, il peut être facile, même tentant, de discriminer une personne parce que son nom de famille est long, bizarre et dur à prononcer (faute des perceptions, mais nous y reviendrons plus tard). Autre exemple, il est aussi facile (pour certains) d’appeler une personne, « l’arabe », tout simplement parce que cette personne porte des traits physiques similaires à une personne arabe. La personne ne sait pas si « l’arabe » est réellement arabe, mais l’appel ainsi, car ils sont supposément « tous pareils ». Pour renchérir, pourquoi appelle-t-on les américains ayant la peau noire: « African American »? Pourquoi avons-nous besoin de mentionner qu’ils sont AFRO-américains? Ils ne sont pas d’origine africaine… Alors pourquoi ne sont-ils pas seulement des américains? Finalement, les Premières Nations; nous les « connaissons » sous le nom d’autochtones, mais elles sont tellement plus. Chaque nation porte un nom et pourtant, je ne peux en identifier plus que cinq (Hurons-Wendats, Inuits, Innus, Mohawks et Micmacs) . Encore pire, je ne serais même pas capable de les différencier. Nous avons réellement tendance à les représenter sous une seule et même identité. C’est triste, mais c’est la réalité.
La notion du désordre (réflexion à partir du texte de Joséphine Bacon)
Comme un effet domino, le désordre créer une perte d’équilibre, ce qui brise l’ordre naturel et amène des nombreuses conséquences. La création des pensionnats pour assimiler les enfants de ces peuples autochtones est un exemple de désordre. Le but de ces pensionnats était très clair: « Les pensionnats avaient pout but de « tuer l’Indien dans l’enfant » ». En plus d’être privé de ses parents, l’enfant doit abandonner son identité, sa culture et sa langue (perte d’équilibre). L’ordre naturel se voit brisé; l’enfant est totalement dénaturé, l’enfant n’est pas respecté et l’enfant restera traumatisé bien plus longtemps que les années passées au pensionnat.
S’approprier… sans demander
Demande-t-on la permission pour voler dans un dépanneur? Demande-t-on la permission pour faire du plagiat lors d’un examen? Bien sur que non, car nous savons que nous n’avons pas le droit et que ces actions ne sont pas justes. Et bien, pour arriver à ses fins, le Blanc a alors décidé de tromper les peuples en leur faisant pratiquement à croire qu’il leur faisait une faveur (basé sur la lecture comparée). Je pris en note un extrait du texte de Joséphine Bacon: « Si la relation est basée sur l’égalité, l’échange, la curiosité et le respect de l’autre, l’harmonie apparaît ». Je me demande qu’elle tournure les événements auraient pris si la relation avait été basée sur ces dernières valeurs… Mais comment espérer trouver l’harmonie, quand la relation est basée sur la tromperie.
L’importance de la culture (sa culture)
Peut importe la culture, notre culture nous donne dans un sens, un sentiment d’appartenance. On incarne plusieurs valeurs de notre culture et nous sommes fière de la représenter. Étant haïtienne, je suis fière de porter mon « afro », ce qui n’a pas toujours été le cas. Pourquoi? Car à l’école, j’étais entouré de filles aux cheveux lisses. Je voulais donc moi aussi avoir les cheveux lisses; je ne voulais pas être différente et j’avais l’impression que ma culture n’avait pas sa place au Collège Laval. Pour renchérir, la fois où j’ai décidé d’assumer mes cheveux en me présentant à l’école avec mon afro (secondaire 4), le directeur est venu me chercher dans ma classe et m’a demandé: « si ça serait possible de faire quelque chose avec mes cheveux, car ça ressemble à une boule disco des années 70′ ». Je lui ai répondu: « Oui, certainement » (d’un air surpris). Pour faire une histoire courte, suite à un appel de ma mère, j’ai pu continuer à porter mes cheveux naturels et le directeur s’est excusé. Bref, mes cheveux sont ma manière d’exprimer ma fierté par rapport à ma culture et personne ne devrait se donner le droit de décider si cette culture est « acceptable » ou non. On naît dans une certaine culture et selon moi, on devrait avoir le droit de décider si nous désirons grandir dans celle-ci.
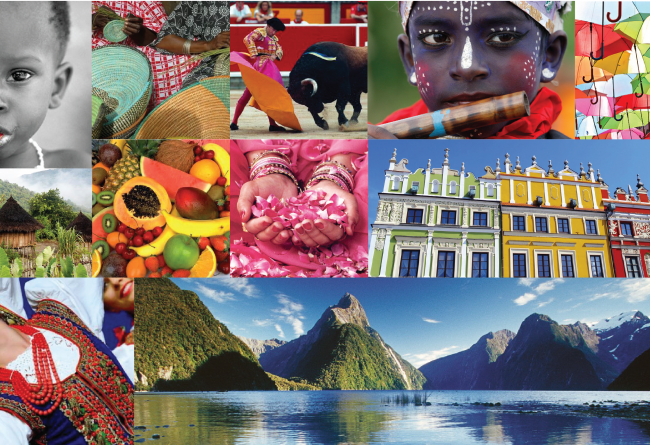
Comprendre au lieu de défendre…
Pour continuer sur l’importance de la culture, selon moi, on ne peut pas penser qu’une culture est supérieure à une autre. Dans ce cas, nos perceptions sont selon moi, nos pires ennemis. Il est possible et acceptable de ne pas comprendre une culture, mais nous devons tout de même la respecter. Vouloir assimiler une culture, car ses valeurs ne correspondent pas aux nôtres est selon moi, inacceptable. Je vous laisse sur un extrait du texte de Jim Harrison, « Seule la terre est éternelle », qui m’a particulièrement marqué: « J’ai appris qu’on ne peut pas comprendre une autre culture tant qu’on tient à défendre la sienne coûte que coûte ».
Je crois que nous sommes prêts (du moins, je suis prête) à tenter de répondre à cette question: faut-il absolument passer par la reconnaissance, avant d’envisager la réconciliation? (question de rédaction)